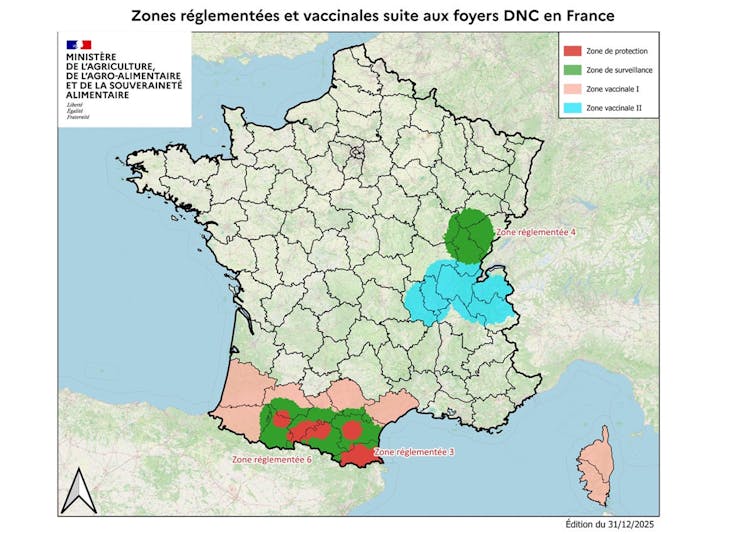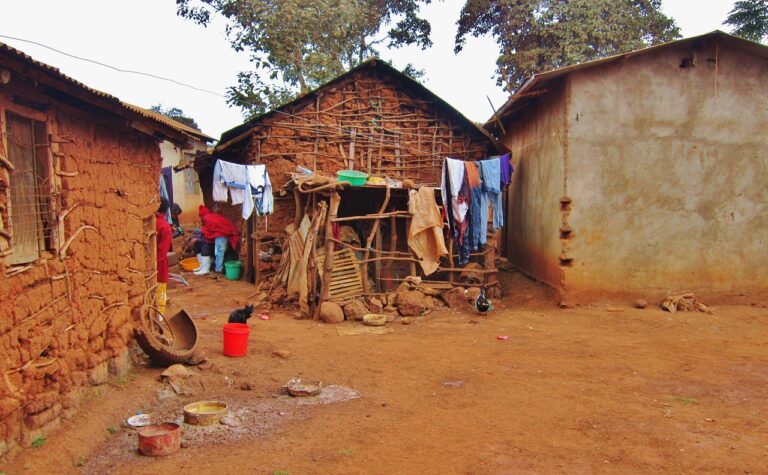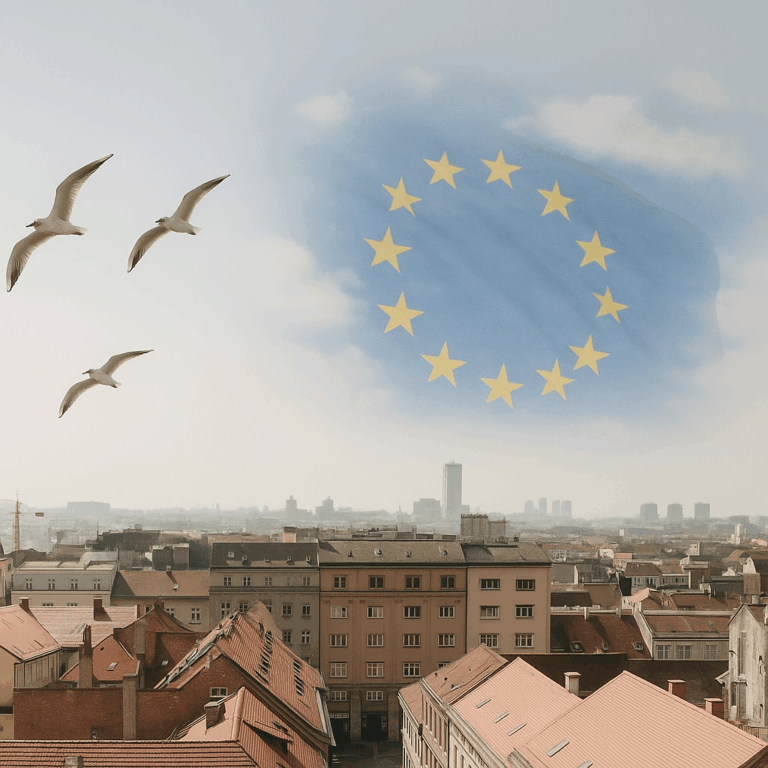Une enquête nationale, menée par l’Anses, dresse le panorama le plus complet à ce jour des pratiques de contrôle des parasites internes chez les équidés en France. Sur 42 528 questionnaires envoyés, 4 344 réponses exploitables ont été recueillies, couvrant 93 % des départements français. Les résultats confirment un décalage entre les usages sur le terrain et les recommandations visant à limiter la résistance aux anthelminthiques (recours systématique à la vermifugation, faible adoption de traitements sélectifs, dosage souvent approximatif, mauvais entretien des pâtures…).
Table des matières
Un état des lieux chiffré couvrant tout le territoire
La cartographie des réponses montre une surreprésentation du Nord-Ouest (26,1 % des réponses), avec des foyers de participation plus importants dans le Calvados et la Loire-Atlantique. Environ sept répondants sur dix ne sont pas des professionnels, ce qui rend compte de la réalité de la gestion parasitaire dans les structures de loisirs et les petites écuries.
Administration fréquente de vermifuges, même lors de risque faible
Selon l’âge des chevaux, 65,3 à 90,4 % des détenteurs déclarent traiter de façon systématique, même en l’absence de risque majeur d’infestation. Le recours à une même famille d’anthelminthiques prédomine : l’ivermectine est utilisée par 73,7 % des répondants chez les poulains et par 92,1 % chez les chevaux de plus de 1 an, une pratique propice à la sélection de parasites résistants.
Adoption encore marginale de traitements sélectifs
Malgré les recommandations européennes et nord-américaines, l’approche fondée sur les tests diagnostiques en parasitologie (coproscopie, seuils d’excrétion fécale, parasites ciblés) reste l’exception. Seuls 5,2 % des répondants déclarent réaliser des analyses coproscopiques et pratiquer un traitement sélectif chez les chevaux de plus de 1 an. Rapporté à l’échantillon, cela représente quelque 226 détenteurs sur 4 344. Autrement dit, près de 19 sur 20 continuent de vermifuger à l’aveugle, sans quantifier l’excrétion d’œufs ni évaluer l’efficacité post-traitement.
Des dosages approximatifs
Environ 70 % des répondants estiment le poids de leur cheval visuellement ou administrent une dose standard identique à tous les chevaux (3 041 déclarations sur 4 344). Cette pratique expose soit à un sous-dosage, facteur reconnu de la résistance aux anthelminthiques, soit à un surdosage inutile, entraînant un surcoût et des risques iatrogènes.
Une gestion sanitaire des pâtures insuffisante
Côté prévention environnementale, si la rotation des pâtures est largement mise en œuvre (environ 80 % des répondants y ont recours), le ramassage des crottins plusieurs fois par an n’est effectué que par 27 % d’entre eux. Le pâturage mixte avec des ruminants, une pratique pourtant bénéfique pour limiter le niveau d’infestation des parcelles par les larves de strongles, n’est cité que par 18 % des répondants.
Des traitements peu ciblés et systématiques
La fréquence de vermifugation augmente chez les professionnels par rapport aux particuliers, chez les poulains par rapport aux adultes, et chez les galopeurs par rapport à d’autres groupes de races. Ces différences de stratégie traduisent des contraintes sportives et des facteurs de risque spécifiques, mais elles soulignent aussi que la gestion sanitaire n’est pas fondée sur les résultats des analyses coproscopiques et sur le contrôle de l’efficacité après traitement via des tests de réduction de l’excrétion fécale d’œufs.
Le rôle clé du vétérinaire
Parallèlement aux protocoles de vermifugation vétérinaires, 20,6 % des répondants (895 détenteurs) déclarent utiliser des produits alternatifs ou complémentaires, souvent achetés en ligne. Cette dispersion des méthodes complique la traçabilité et l’évaluation des résultats, surtout en l’absence de coproscopies de suivi. Toutefois, malgré ces pratiques différentes, le vétérinaire demeure la première source de conseil pour établir un plan de vermifugation. Ce rôle privilégié contribue à faire évoluer les usages vers des stratégies éprouvées (coproscopies régulières, traitement sélectif des chevaux fortement excréteurs, dosage selon le poids réel, contrôles d’efficacité, intervalles de traitement).
Des chiffres en faveur d’un changement de stratégie
Additionnés, ces résultats dessinent une approche à l’efficacité décroissante (vermifugation non ciblée, emploi d’une seule molécule, dosage imprécis, gestion sanitaire irrégulière des pâtures). Or l’arsenal thérapeutique équin reste limité à quatre classes d’anthelminthiques ; en réduire l’efficacité par des pratiques peu sélectives revient à hypothéquer le contrôle parasitaire à moyen terme, avec à la clé des échecs cliniques, des coûts accrus et un risque de maladie chez les chevaux les plus sensibles.
Ce que recommande la littérature
La stratégie gagnante repose sur quatre piliers. D’abord, mesurer le risque parasitaire avant de traiter (coproscopies, tests diagnostiques). Ensuite, doser juste, selon le poids réel du cheval et non une estimation. Troisièmement, assainir les pâtures (rotation, ramassage régulier des crottins, copâturage raisonné, hersage). Enfin, établir un plan de vermifugation individualisé (protocole sélectionné par le vétérinaire, traçabilité des traitements, abandon des pratiques alternatives).
Cette enquête fournit une base chiffrée pour réorganiser la lutte contre les parasites digestifs chez le cheval en France. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 226 détenteurs seulement déclarent pratiquer un traitement ciblé, 3 041 dosent encore approximativement le vermifuge administré, 3 500 pratiquent la rotation des pâtures mais 1 180 seulement ramassent régulièrement les crottins. L’adoption d’un plan de vermifugation raisonné et sélectif n’est pas une option : c’est la condition pour préserver l’efficacité des molécules antiparasitaires, la santé des chevaux et l’équilibre économique des écuries.